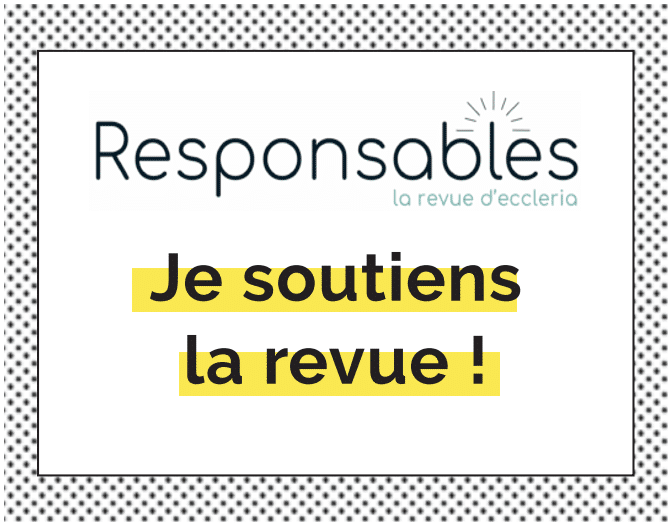Henri Laux sj
Docteur en philosophie, professeur de philosophie aux Facultés Loyola Paris.
Henri Laux a écrit en 2017 un livre intitulé Pour une existence spirituelle. Il contient notamment deux chapitres qui peuvent éclairer cette réflexion : « L’enjeu spirituel du moment présent » et « Éthique et vie spirituelle », Éditions Facultés jésuites de Paris.

Henri Laux sj
Docteur en philosophie, professeur de philosophie aux Facultés Loyola Paris.
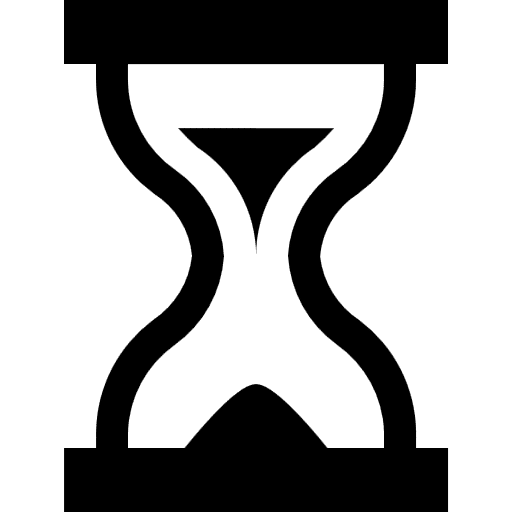
regard spirituel
Politique : le dialogue au service de la cité
Dans un monde meurtri par la violence, il est bon de rappeler la puissance du dialogue et l’importance de préserver les conditions de sa réalisation. Eclairage éthique et spirituel.
Il existe une tradition, notamment chez des philosophes de l’Antiquité — Aristote en particulier — qui dit que l’homme est porté naturellement à vivre avec d’autres. Ce n’est pas faux, au sens où l’homme ne se sent pas fait pour vivre seul, où il apprécie la rencontre et dans la mesure aussi où il y trouve son intérêt.
Il y a une rupture à l’époque moderne, spécialement avec le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588–1679), qui récuse l’idée que l’homme serait par nature un être spontanément porté au bien et lié avec autrui. Au contraire, il pose que, au commencement de l’humanité, il y a « l’état de nature ». Dans cet état, chacun exerce un droit correspondant à sa nature, à sa force et à toutes ses capacités : le droit d’assurer son existence par tous les moyens, des plus brutaux (la force pure) aux plus subtils (la ruse). Les individus s’affrontent pour défendre ce qui leur appartient et s’approprier le bien, voire la vie des autres. Hobbes résume cette situation en parlant de « la guerre de chacun contre chacun ».
L’état politique : un cadre pour dépasser la violence
C’est une expérience commune et quotidienne que nous faisons tous et que font nos sociétés. Les occasions de conflit sont nombreuses. Ce qui joue dans cet état de nature, c’est la crainte, la peur de l’autre. La crainte de l’autre est structurante de la vie sociale. On va rétorquer : c’est une vue bien pessimiste. N’est-elle pas plutôt réaliste ? Hobbes répondait d’ailleurs, et je traduis pour aujourd’hui : quand vous avez quitté votre maison, vous l’avez bien fermée à clé ; quand vous avez garé votre voiture, vous l’avez bien fermée à clé… Pourquoi ? Parce que vous craignez les autres, parce que vous vous protégez devant la menace. Mais là n’est pas le dernier mot de l’humanité.
La crainte de l’autre est structurante de la vie sociale. Mais là n’est pas le dernier mot de l’humanité.
Le dépassement de cette guerre permanente va s’opérer dans le passage à « l’état civil ». Chacun renonçant à exercer son droit propre, l’autorité politique est confiée au pouvoir commun qui naît de ce renoncement. La liberté de l’individu s’exerce désormais dans un cadre qui impose à tous les mêmes obligations. Ce dépassement par la politique ne s’est pas fait hier une fois pour toutes ; c’est une réalité de tous les instants. La violence est toujours présente ; il est de l’intérêt des humains de la dépasser toujours.
Les relations internationales en sont une bonne illustration : les États sont les uns à l’égard des autres dans « un état de nature » où les plus forts l’emportent sur les plus petits, avec toutes sortes de rapports de force. Mais il y a la tentative de surmonter la violence — ou du moins trop de violence — ne serait-ce que pour qu’une activité économique, un commerce, des échanges soient possibles ; et nous préférons tous vivre paisiblement. D’où l’existence d’un droit international, qui vaut ce qu’il vaut, avec toutes ses limites, mais qui existe. D’où les institutions internationales : la Société des Nations (1919), puis l’ONU (1946) et ses composantes. Quand cela ne fonctionne pas bien, on s’en aperçoit très vite !
Il revient à l’État d’intégrer différentes dimensions (techniques, éthiques, culturelles, historique). Or il y a de la diversité en tout cela. Cette diversité, qui est aussi une richesse, risque toujours de menacer une nécessaire unité. L’État doit travailler à intégrer des positions différentes dans une communauté sans que celle-ci se désintègre. C’est là que le dialogue intervient.
Au principe de la vie en société, il y a une parole échangée
L’État est cette totalité dynamique dans laquelle se rejoignent des dimensions différentes pour aboutir à des décisions qui s’imposent à tous. La discussion est alors le lieu vivant où des affirmations diverses, parfois contraires, se rencontrent, s’exposent en raison, apprennent à se laisse transformer et, par de nécessaires compromis, définissent une attitude qui permette une vie en commun. Les partis politiques, les associations, les syndicats, les institutions représentatives jouent un rôle privilégié.
La démocratie est le régime dans lequel les citoyens parlent et se parlent : ils sont honorés dans leur parole et honorent la parole d’autrui, renonçant à la ruse et au mensonge qui pervertissent le lien social. Une communauté est politique quand elle s’appuie sur la parole de ses membres pour briser le cercle de la violence. Elle travaille alors par le jeu de la discussion à une unité voulue, négocié, nuancée, tout à l’opposé de l’uniformité totalitaire. Ce qui définit alors au mieux la démocratie, ce n’est pas une définition juridique, c’est la présence active du dialogue, de la discussion.
Ce qui définit au mieux la démocratie, c’est la présence active du dialogue. Il faut savoir se parler, s’écouter, argumenter. Et cela n’est pas étranger à une inspiration chrétienne.
Ce dialogue obéit à des règles. Dans une assemblée, il y a des procédures à respecter : le dialogue suppose de donner des raisons, de rendre compte de la manière la plus objective de ce qui est. Dans les relations internationales, il y a la diplomatie (le Saint-Siège a aussi une activité diplomatique) : on cherche à se parler, même et surtout en secret, en tout cas avec discrétion. Dans le dialogue entre personnes, il y a aussi des manières de faire : il faut savoir s’écouter, argumenter. Et cela, qui est profondément humain, n’est pas étranger à une inspiration chrétienne.
La force de la vie spirituelle pour inspirer l’action et le dialogue
Le chrétien se doit de se comporter en citoyen. C’est une évidence à rappeler. Il se doit de partager les procédures de la raison, de construire une humanité commune. Or le chrétien peut être tenté de se construire un monde à part, d’apporter ses sentences de jugement ou de condamnation. S’il est légitime d’apporter des convictions, de témoigner de certaines valeurs, cela doit entrer dans les procédures communes de notre humanité, le terrain sur lequel on se rencontre.
J’ajoute que « la vie spirituelle chrétienne a de quoi inspirer particulièrement l’action et le dialogue ». Elle offre de belles ressources pour orienter l’action. Voici quatre attitudes, à la manière du Christ, qui doivent inspirer le chrétien.
La vie spirituelle chrétienne a de quoi inspirer particulièrement le dialogue, elle offre de belles ressources pour orienter l’action
Apprendre à rencontrer l’autre. Le Christ nous parle de la relation à l’autre ; la manière dont il se rapporte à autrui est très éclairante : son attitude est celle de l’accueil et de la disponibilité. Jésus se laisse surprendre ; il se laisse déranger, presque toujours en chemin, allant d’un lieu à un autre, parcourant le pays en tous sens. Or, le chemin expose à la rencontre imprévue, dangereuse parfois, réjouissante d’autres fois, imprévisible toujours. Le Christ ne fuit pas la rencontre. Il est affecté par des situations très concrètes, par les malades et ceux qui souffrent.
Être attentif à la fragilité humaine. Pas seulement en début et fin de vie, ce qui est déjà complexe, mais toutes les phases de la vie. La philosophe Simone Weil écrit que « l’attention » est la forme la plus pure de la générosité. Être attentif, s’intéresser à l’autre, l’écouter et l’écouter jusqu’au bout, c’est exigeant et c’est essentiel. Et davantage encore, rester attentif au plus petit. « Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait » (Mt 25, 31–46).
Rester libre. « Heureux les cœurs purs » (Mt 5, 8) : la pureté du cœur désigne une disposition que l’on peut comprendre comme absence de calcul, gratuité, indépendance, liberté. Beaucoup de nos relations sont faussées parce qu’elles sont soumises à un calcul, cherchant notre seul intérêt. Le cœur pur ne vit pas dans l’inconscience de ses actes, mais il agit de telle sorte que les conséquences en soient de justice et de vérité. Certes, la dimension de la raison intègre aussi du calcul ; il y a nécessairement de la stratégie dans la vie politique, des compromis nécessaires : cela fait partie du vivre ensemble. Mais si c’est le calcul qui conduit tous nos actes, selon que nous devons plaire à l’un ou à l’autre, cela doit interroger notre engagement. On a pu dire dans le passé que le chrétien devait être un allié inconfortable : c’est une manière de reconnaître sa liberté.
Savoir faire silence en soi. Il est vital de prendre du recul, de la distance, de se recueillir. Jésus se retirait régulièrement dans le désert. Il n’y a pas à fuir le monde mais à sortir de ce tumulte où les paroles ne signifient plus rien, n’engagent plus personne, ce tumulte intérieur qui étouffe tous les repères. Faire du tri dans la confusion, ordonner et hiérarchiser les enjeux, écouter la voix de son cœur, ne serait-ce pas le chemin de la prière ?
Souhaitons que le dialogue en politique s’attache à construire la cité, qu’il contribue à permettre une vie véritablement humaine pour chacun, et les uns par les autres, ensemble.
Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s’il me manque l’amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante […] Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés […] s’il me manque l’amour je n’y gagne rien (1Co,13).
Pour aller plus loin
Henri Laux a écrit en 2017 un livre intitulé Pour une existence spirituelle. Il contient notamment deux chapitres qui peuvent éclairer cette réflexion : « L’enjeu spirituel du moment présent » et « Éthique et vie spirituelle », Éditions Facultés jésuites de Paris.